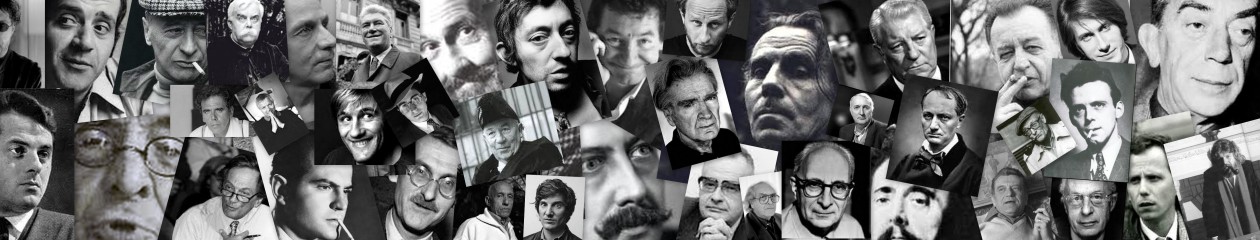Si leurs épées ont pu sommeiller, leurs plumes ne chômèrent guère. La guerre, ils en sont tous les trois revenus. Mais dans leurs perspectives, la guerre n’est pas une réalité que l’on pourrait circonscrire, mais une présence aux contours aussi incertains qu’obsédants. Indispensable à disséquer pour se comprendre soi-même, où l’on va et d’où l’on vient. Montherlant et Vigny, à près d’un siècle d’écart, reviennent ici sur ce qu’ils considèrent constituer l’honneur, là où Céline adopte un tout autre point de vue…
Souvent présenté comme un homme du passé, un rescapé de la vieille chevalerie, Henry de Montherlant se plaisait à revendiquer ses origines aristocratiques et sa fidélité à un ordre disparu. « Je suis par la naissance du parti pris du passé », écrit-il par exemple dans un volume de ses Carnets. Engagé volontaire lors de la Grande Guerre et blessé par un éclat d’obus, torero valeureux, athlète viril , l’auteur est dès le début de sa carrière un « professeur d’énergie ». Qu’il s’agisse de la figure du libertin, du torero ou de l’athlète, le chevalier, au sens large où l’envisage Montherlant, affirme sa valeur dans la violence et dans le combat. Mais il ne s’agira pas chez lui de décrire les batailles ou la vie du soldat au front dans le déroulement de son existence ordinaire, mais de saisir les mouvements profonds et parfois indistincts que la guerre met en branle au plus intime de l’être.
Élevé pour le roi sous l’Empire, dans une famille d’aristocrates pauvres, Vigny commence sa carrière militaire avec la Restauration, à l’âge de 17 ans. Dès lors, il ne connaît guère qu’une vie de garnison sans éclat, qui lui laisse le temps d’écrire ses premiers poèmes. S’en suivent plusieurs congés jusqu’à ce que Vigny obtienne sa réforme définitive, dès 1827. En juillet 1830, Vigny s’engage toutefois dans la Garde Nationale pour défendre l’ordre, mais sans grande conviction ; il ressent cruellement l’ambiguïté du rôle qui échoit alors aux soldats, de protéger la nation contre des ennemis intérieurs. L’avènement d’un roi peu légitime lui permet bientôt de s’estimer libre de tout devoir. Reste cependant un profond malaise, dont Vigny recherche l’origine, en deçà de la période de paix dans les mœurs militaires de l’Empire et de la Révolution. Il porte atteinte ainsi à la légende elle-même qui accentue le mal du siècle en dévaluant le temps présent. De ce malaise allait naitre Servitude et grandeur militaires.
La guerre ? « La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas » (« On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté »), « une formidable erreur », un « abattoir international en folie ». Que révèle-t-elle ? « L’imbécillité infernale » (les gradés en prennent pour leur grade), « la sale âme héroïque et fainéante des hommes », des hommes « dupés jusqu’au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d’autre chose, autant qu’ils étaient, que de tuer et d’être étripés sans savoir pourquoi », bref : « la fuite en masse, vers le meurtre en commun ».
Son enseignement ? « C’est des hommes et d’eux seulement qu’il faut avoir peur, toujours. » Un remède (sans illusion) ? « Quand on sera au bord du trou faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. »