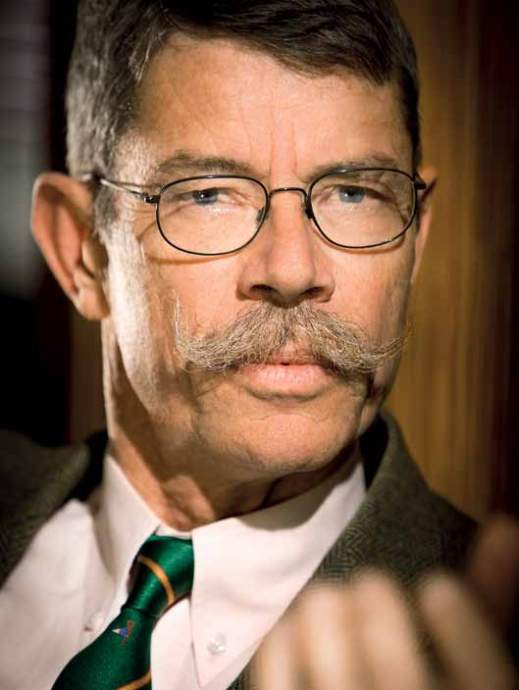Verneuil, ce sont plus de 35 films, une filmographie qui sonne un peu à elle toute seule comme une page de l’histoire du cinéma français. Côté salles obscures; plus de 90 millions d’entrées. Face caméra; une galerie de monstres-sacrés portés au pinacle. En amont; des dialogues en béton, vernis d’une verve verneuillenne.
Faire reluire une certaine tradition du cinéma français avec des techniques et des recettes inspirées du cousin d’Amérique, ça ne date finalement pas d’hier. À mi-chemin entre l’américanophilie habitée d’un Melville et la fidélité tranquille aux principes routiniers du « cinéma de papa », Verneuil fut l’un des plus fervents à chercher l’efficacité technique hollywoodienne pour raffermir une mécanique de spectacle familière au public français. « Bon faiseur d’un cinéma du samedi soir » : cette critique, il la reprend à son compte.
Son style, son genre, lui ont valu les foudres de ceux qu’il appelait les « putschistes » de la « Nouvelle vague », mais lui, se considérait plutôt comme un « conteur oriental ». Rassembler le plus grand nombre et réaliser ainsi des succès commerciaux n’est pas incompatible avec la qualité artistique. Sans doute s’agit t-il là de la grande leçon dispensée par ce metteur en scène mythique.
Apatride… C’est le premier mot de français qu’apprennent sa famille fuyant la Turquie, qui débarquent à Marseille un matin de décembre 1924: le fonctionnaire de police le marque au tampon encreur sur leurs passeports, les autorisant ainsi à rester en France. D’origine arménienne, Achod Malakian est né en Turquie, à Rodosto, le 15 octobre 1920.
Car il faut vivre, et avec un objectif absolu : faire faire des études au petit Achod. Malgré les difficultés évidentes et constantes auxquelles se heurtent ces réfugiés aux maigres ressources, qui parlent à peine français, jamais le clan ne perd l’espoir. Même lorsqu’il rentre épuisé de son dur labeur (de nuit, parce c’est mieux payé), le chef de famille, conteur merveilleux, narre à son Achod des histoire charmantes qui le font rêver. Il se sent exclu par ses camarades issus de la « bonne société » marseillaise, et compense sa solitude en se racontant des histoires. En dépit de son isolement à l’école où, au début, le petit garçon souffre de sa situation d’immigré, la tendresse chaleureuse de tous les instants qui l’enveloppe lui assure un épanouissement certain et la promesse d’un avenir meilleur. En connivence permanente et totale, cette cellule familiale s’organise pour le protéger, le soutenir, l’encourager.
Le poids du passé, le vécu quotidien amènent doucement le jeune garçon à imaginer son avenir avec une grande ambition, pour sortir les siens de leur situation précaire. Un jour, il déclare à sa famille ébahie qu’il veut devenir « ingénieur mécanicien de la Marine militaire ». Pour y arriver, le chemin passe par les Arts et Métiers.
Le garçon se retrouve pensionnaire à Aix-en-Provence pour préparer, en quatre ans, le concours d’entrée. L’an 1940 arrive et, malgré les événements, le concours d’entrée a lieu en juillet. Achod Malakian est reçu « à titre étranger »: il ne sera naturalisé que vingt-cinq ans après son arrivée sur le quai de la Joliette, par un décret du 4 novembre 1949.
Pendant ses trois années à Aix, « Malaks » participe activement aux activités de sa promotion, développant des animations avec un sens musical et artistique évident, mais faisant aussi preuve d’originalité et de caractère. Lors d’une fête traditionnelle, il joue le rôle d’un metteur en scène en plein tournage devant une caméra de carton: hasard prémonitoire ou prémices d’une vocation ?
Son diplôme en poche, il s’oriente d’abord vers le journalisme. De 1944 à 1946, il est rédacteur en chef du magazine « Horizon », puis critique cinématographique et radioreporter. C’est alors qu’il s’essaye au court-métrage. En 1947, sa rencontre avec Fernandel et l’amitié qui en découlera seront des éléments déterminants de sa carrière. L’acteur accepte de tourner avec lui, un inconnu, un court-métrage sur Marseille: « Escale au soleil ».
Le jeune réalisateur est devenu entre-temps Henri Verneuil. « Dès cette époque, soulignerat-il plus tard, j’ai toujours fait ce métier avec entrain et jubilation. Si on tourne un film avec plaisir, on évite l’ennui à coup sûr. Tout le monde aime une histoire bien racontée : à l’écran, c’est la même chose. Il faut savoir placer la caméra au bon endroit et avec le bon angle, pour donner à l’histoire le maximum de vérité et de vie. Cet art de raconter, avec des moyens visuels, me vient sans doute de mon père qui possédait ce merveilleux talent souligné de gestes expressifs. »
A partir d’ici, merci à Laurent Ziliani
De 1946 à 1951,signant donc du nom d’Henri Verneuil il réalise une vingtaine de courts-métrages : comédies de première partie (À la Culotte de Zouave), évocations musicales (Cuba à Montmartre), tentatives insolites (Maldonne). Lors du tournage d’Escale au soleil, en 1948, il rencontre Fernandel qui, deux ans plus tard, accepte d’interpréter son premier long-métrage : La Table aux crevés. Pour son premier film, Verneuil transpose le célèbre livre de Marcel Aymé, prix Renaudot en 1929, à un village de Provence. Il parvient toutefois à en préserver un certain esprit de « querelles de village », mais le film ne décolle jamais vraiment. Fernandel est égal à lui-même, excellent, mais envahissant et cabotin.
Monstre sacré, Fernandel place le réalisateur devant ses responsabilités : « Il m’a appris à diriger les acteurs, car j’ai compris que si je n’y arrivais pas avec lui, je me ferais dévorer tout cru. »
L’audace est payante. Le comédien redouté offre dès lors son concours, et parcourt avec lui toute la gamme de son talent : chronique provençale (Le Boulanger de Valorgue, 1952), pagnolade un peu fade. En dépit de la musique de Nino Rota, et bien que les dialogues de Jean Manse ne déparent pas — il y a même quelques traits acides, un des villageois déclarant par exemple « Je n’ai pas capitulé en 40 : mon bureau est resté ouvert » tout comme des allusions au marché noir — la trame reste trop classique
Film après film, Verneuil décroche des budgets de plus en plus importants. Son film suivant, L’Ennemi public n°1 (1953), est un hommage au screwball à l’américaine. A New York, à l’époque de la prohibition, Joe Calvet est un démonstrateur particulièrement timide et myope. Il ne peut pas voir à plus de vingt centimètres sans ses lunettes, et n’a presque aucune personnalité. Parce qu’il échange malencontreusement son imperméable avec celui d’un redoutable criminel, la police l’appréhende et il est jeté en prison. A la faveur de nombreux quiproquos, il réussit toutefois à fausser compagnie aux gardiens et rejoint la bande de malfrats qui le prennent pour leur chef. Comme on peut aisément le deviner à travers ce petit résumé, le scénario de Max Favalelli manque d’originalité. La présence de Sza Sza Gabor, de Saturnin Fabre ou de Louis Seigner, mais surtout de Fernandel rendent la farce agréable à voir, bien qu’elle n’échappe à aucun moment aux clichés.
En 1954, Le Mouton à Cinq pattes lance Verneuil dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger. Il n’obtiendra pas la fameuse statuette, mais c’est un signe que Verneuil, qui a maintenant 34 ans, maîtrise parfaitement le langage cinématographique. Le rythme est énergique, les acteurs excellents. Dans Le Mouton à Cinq Pattes, Fernandel, au sommet de sa forme, interprète six rôles, à la manière d’un Alec Guiness ou d’un Peter Sellers.
Dans un petit village, des quintuplés sont nés. Après leur enfance sans histoire, la vie les a séparés. Ils ont maintenant quarante ans. L’un est directeur d’un institut de beauté, l’autre est devenu un laveur de carreaux hypocondriaque, le troisième s’occupe du courrier du cœur dans un magazine, un autre est marin, et le dernier est aujourd’hui curé. Le maire a l’idée de les réunir à nouveau.
drame sentimental (Le Fruit défendu, 1952).
Et puis en 1959, c’est le très célèbre La vache et le prisonnier, leur dernière collaboration, la plus aboutie, et l’un des derniers grands films de Fernandel. De nombreuses rediffusions à la télévision n’ont pas su banaliser une trame de qualité.
Qui ne connaît pas encore La Vache et le Prisonnier ? Bailly (Fernandel) est prisonnier de guerre en Allemagne. Il y travaille dans une ferme. La vie n’est pas trop dure pour lui, pourtant le pays lui manque. Il décide de s’évader, et il a pour cela une idée pour le moins originale. Bailly s’évadera à pied, en uniforme de prisonnier de guerre, avec une vache. Ainsi, nul ne pourra s’imaginer qu’il prend la clé des champs. Bailly part sur les routes, et son idée paraît fonctionner à merveille. Un peu à la manière de la « La lettre volée » de Poe, le principe selon lequel le meilleur moyen de dissimuler quelque chose ou quelqu’un est de l’exposer aux yeux de tous fonctionne à merveille pour Bailly. Les scénaristes ont de la sorte disséminé des histoires authentiques et simples au fil de l’intrigue. Le tour de force de Verneuil est de faire de la vache Marguerite un vrai personnage. Lorsqu’il est temps pour Bailly de l’abandonner, une vraie émotion le saisit, que nous partageons.
Après 1959, Fernandel et Verneuil ne retravailleront plus ensemble. Verneuil a pris d’autres voies, délaissant la comédie, et Fernandel, sur le déclin, se fait vieux.
D’une longue collaboration avec Fernandel, Verneuil, de son propre aveu, aura appris avant tout à ne pas se laisser dévorer par un acteur qui peut être despotique. Fernandel lui a offert sa confiance et sa protection, et lui a apporté ainsi succès et popularité.
ACTE II
Entretemps, Verneuil a fait d’autres rencontres capitales, celle de Gabin notamment, avec qui il tournera cinq films, mais aussi Charles Boyer ou Françoise Arnoul.
Dès 1952 en effet, Verneuil collabore avec d’autres grands : Michel Simon dans le rôle de Maigret (Brelan d’As, 1952), puis Françoise Arnoul et Daniel Gélin en 1954 dans le magnifique Amants du Tage, d’après Kessel.
Mais tout le talent de Verneuil éclate en 1955, avec Des gens sans importance, qui reste sans doute l’un des ses meilleurs films.
Jean Viard (Jean Gabin) est un routier dans la quarantaine. Il n’est pas souvent à la maison, et quand il y est, il ne s’entend guère avec sa femme Jacqueline (Danny Carrel) et ses deux enfants. Ses longs périples répétés sur les routes lui ont donné l’habitude de se restaurer dans la même auberge, où sert la jeune Clothilde (Françoise Arnoul). Une idylle naît entre eux, qui se transforme en relation passionnée. Dès lors Jean s’intéresse davantage à Clothilde qu’à son travail, et se détache de sa famille.
Plus que jamais dans ce film, Verneuil parvient à saisir la banalité du quotidien, à travers les gestes ordinaires, les habitudes. Une mélancolie permanente survole le film. La relation entre Clothilde et Jean est évidemment vouée à l’échec dès le départ. Le spectateur, tout comme Berty, l’ami de Jean interprété sobrement par Pierre Mondy, ne l’ignorent jamais, et dès lors sont condamnés à assister à la triste dégradation de Clothilde et Jean, malgré leur passion toujours présente.
La désagrégation du couple Jacqueline / Jean, tout comme que le comportement indécis et un peu désinvolte de Clothilde ont la même origine : l’ennui, et c’est par cette composante que tous deux, qui n’ont par ailleurs pas grand-chose en commun, se rejoignent et s’unissent dans une véritable passion destructrice.
Le film a vieilli, mais la qualité de ses interprètes (Jean Gabin, plutôt discret et très attachant, et Françoise Arnoul, fragile et fascinante donnent une de leurs meilleures performances) et la photo impeccable de Louis Page le classe parmi les classiques des années 50.
C’est en dirigeant Charles Boyer que Verneuil réussit à renouveler l’exploit d’une peinture fine et juste de personnages « sans importance ». Malgré une première collaboration en demi-teinte (Paris Palace Hôtel, 1956), Boyer et Verneuil se retrouvent dans Maxime, avec Arletty et Michèle Morgan, un film majeur dans l’œuvre de Verneuil, bien qu’il fût peu remarqué à l’époque de sa sortie, et qu’il reste aujourd’hui très méconnu.
Dans les années qui suivent, Verneuil continue à beaucoup tourner. Il retrouve Gabin, avec notamment Le Président, où Gabin est aux côtés de Bernard Blier dans une adaptation de Simenon.
Le vieux Président à la retraite Emile Beaufort (Jean Gabin) vit aujourd’hui retiré dans une villa. Il n’intervient plus du tout dans la vie politique, et se consacre plutôt à des petites promenades ou à ses mémoires. Mais lorsqu’il entend à la radio que Chalamont (Bernard Blier), son ancien chef de cabinet, est en passe de devenir président du conseil, il sait que leurs routes vont devoir se croiser une dernière fois.
Malgré une scène remarquablement filmée au palais Bourbon, (le débat mouvementé concerne la construction européenne !), le film ne parvient pas à convaincre surtout à cause du jeu de Gabin, qui « gabine » comme jamais. En outre, tout y est vieilli et représenté avec une absence totale de réalisme.
Après La Vache et le Prisonnier (1959), qui clôt la période Fernandel, Verneuil poursuit sa carrière en réalisant un sketch du film La Française et l’Amour (1960). Le film composé de sept sketches (réalisés notamment par Boisrond ou René Clair) est un fiasco.
Un Singe en hiver est l’adaptation du roman d’Antoine Blondin, anar majeur, hussard devant l’éternité (prix Interallié 1959). Albert Quentin (Jean Gabin), buveur invétéré, et sa femme (Suzanne Flon) tiennent un hôtel dans un village de Normandie. L’alcool permet à Albert de retrouver le Yang Tseu-Kiang et de rêver à une autre vie. Mais voilà que les bombardements alliés pilonnent le village, et Albert et Suzanne se réfugient dans la cave de leur maison. Là, Albert promet à sa femme de ne plus jamais boire d’alcool.
Quelques années ont passé. Albert a tenu sa promesse. Pourtant, un soir, Gabriel Fouquet (Jean-Paul Belmondo) prend une chambre dans leur hôtel. Quitté par sa femme, il se soûle régulièrement pour oublier. Suzanne sent bien que c’est un mauvais exemple pour son mari et craint qu’à la vue de Gabriel, il rechute. Belmondo, star naissante du cinéma populaire (il vient de faire Cartouche) mais aussi un des symboles de la Nouvelle Vague (A bout de souffle) et Jean Gabin, le monstre sacré du cinéma français, réunis par l’alcool : le cocktail semble singulier, mais Verneuil a tapé juste, son film est profondément humain, en permanence sur le fil entre drame et comédie. Deux hommes faibles et malheureux, qui se comprennent à mi-mot, l’un en Espagne, l’autre sur le Yang Tseu-Kiang, grâce à la boisson qui les rend complices.
Humain et humaniste, le propos du film est aussi un hymne à l’ivresse, à la tentation. Il promeut la fantaisie et s’attendrit devant la faiblesse de ces deux hommes. Il affiche son affection pour ces deux enfants, encense leur désinhibition, plutôt que les faux-semblants, les hypocrites, les tricheurs comme cette mère supérieure qui prétend être anglaise, ces villageois qui attendaient patiemment et sans pitié qu’Albert se remette à boire. Il était inéluctable qu’Albert retournât vers la boisson. Il avait remplacé les verres d’alcool par les bonbons par amour pour sa Suzanne. Mais Albert est probablement incurable, il pleure sa jeunesse perdue, la vie qu’il n’aura plus jamais.
Le cas d’Antoine est différent. Quitté par sa femme, les racines de son malaise ne sont pas aussi profondes, mais il est blessé, perdu. Ils ont une génération d’écart, des vies et une situation familiale différentes (Antoine a un enfant), tout les sépare, à part une blessure commune qui les unit ponctuellement. Un Singe en Hiver démontre une nouvelle fois la capacité de faire de Verneuil le peintre de personnages simples et émouvants.
Avec les mêmes qualités, en 1964, Verneuil adapte Week-end à Zuydcoote, d’après Robert Merle. Malgré un gros budget et des milliers de figurants, le film échappe à la lourdeur des films historiques, parce que Verneuil se concentre sur le quotidien de quelques hommes qui pourraient être n’importe qui. Il convient de resituer brièvement le cadre historique. Mai 1940, les Allemands entrent en France après avoir écrasé la Hollande. Ils percent la défense alliée et atteignent Abbeville le 20 mai. Les soldats britanniques et français se retrouvent isolés dans la « poche de Dunkerque ». Mais le 24 mai au soir, Hitler ordonne l’arrêt des forces blindées(*). Grâce à ce répit, les Alliés se regroupent autour de Dunkerque et s’apprêtent à embarquer pour l’Angleterre.
C’est dans ce contexte assez méconnu que se joue Week-End à Zuydcoote. Zuydcoote est un village côtier du Nord, près de Dunkerque, dans lequel des milliers de soldats Alliés dont Maillat (Jean-Paul Belmondo), ses camarades Pierson (Jean-Pierre Marielle) ou Ahery (Pierre Mondy) se retrouvent acculés sous la poussée allemande. La survie s’organise. Ahery prépare son retour à la France occupée, tandis que Maillat cherche à tout prix à s’embarquer pour l’Angleterre. Il parvient à trouver un bateau mais il est coulé et Maillat se retrouve à son point de départ. De retour à Zuydcoote, il rencontre une jeune fille, Jeanne (Catherine Spaak) qui refuse de quitter sa maison, quoiqu’en sursis à cause des pilonnages allemands.
Week-End à Zudycoote est un film sans héros, qui montre un aspect inhabituel de la guerre, avec ses drames personnels, insignifiants à l’échelle mondiale mais tragiques à une échelle humaine.. Les soldats oisifs survivent comme ils le peuvent, certains pillent, trafiquent, violent, ou préparent l’après-armistice. Le film parvient à rendre avec force l’horreur et l’absurdité de la guerre, mais aussi celles des hommes. Un couple anglo-français tente de s’enfuir pour l’Angleterre et meurt dans le bombardement de leur bateau. Un militaire périt en allant chercher de l’eau. Des soldats violent une villageoise qui se refuse à abandonner sa maison bombardée…
Pourtant, le film ne se réduit pas à ses personnages. Les quelques scènes de guerre que Verneuil choisit d’intégrer à son récit sont mémorables. Il est difficile d’oublier ce parachutiste allemand fusillé par des centaines de soldats avant même qu’il ne touche le sol. Il en va de même pour le réalisme époustouflant des scènes de bombardements.
La même année, il réalise et scénarise une autre pépite cultissime. Aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de transports routiers. Hans doit conduire un chargement clandestin de cent mille dollars au coeur de l’Afrique. L’apprenant, Rocco élimine le chauffeur, vole son véhicule et part avec sa complice. Castigliano promet alors une forte récompense à Marec s’il récupère le camion. Commence une folle poursuite… Bébel, Lino et Blier réunis pour une ironie et une intrigue à jubiler sans souffler.
Ainsi, Verneuil, à travers ces quelques films, a prouvé qu’il savait être riche d’humanité, tout en restant fidèle au grand public. Avec presque deux films par an entre 1951 et 1964, il a été un cinéaste français (et un anar de droite) majeur.
Henri Verneuil a désormais 44 ans. En remportant le Golden Globe du meilleur film étranger, il a attiré les regards des producteurs étrangers. Il s’agit du polar à l’américaine Mélodie en sous-sol (1961), d’après le thriller éponyme de John Trinian (dont le titre original est The Big Grab). Pour l’adapter au cinéma, le scénariste Albert Simonin a transposé le hold-up du livre au casino du Palm Beach à Cannes, il a francisé les noms, modifié la fin, et Henri Verneuil a su le mettre en images dans un suspense haletant.
Charles (Jean Gabin), vieux gangster fraîchement sorti de prison, décide de faire un dernier coup avant de se ranger. Son idée est de ravir la caisse d’un grand casino. Il fait du jeune Francis (Alain Delon) son complice, et tous deux commencent à exécuter un plan compliqué dont le terme est le braquage de la caisse, au sous-sol du casino.
Le film est un modèle du genre. Le rapport entre Charles, le vieux bandit expérimenté qui veut se ranger après un dernier coup, le plus gros de sa carrière, et Francis, le jeune et beau voyou un peu trop sûr de lui, est un parangon pour de nombreux films de gangsters. Entre eux s’instaure une relation conflictuelle, qui tient du rapport père / fils.
Avec sa réalisation impeccable et sa fin inoubliable, le film est remarqué aux Etats-Unis. Il décroche le Golden Globe du meilleur film étranger, bien qu’il soit peu apprécié par les critiques français. Il faut dire qu’Audiard est à l’opposée de la Nouvelle Vague qui secoue le cinéma hexagonal, et dans ce contexte de renouveau, Verneuil et Gabin, c’est un peu du « cinéma de papa ». Toujours est-il qu’avec ce film, Verneuil s’ouvre les portes des Etats-Unis. Il se rend à Los Angeles.
Verneuil parlait assez volontiers de cette époque dans les interviews, pendant laquelle il avait pu assister dans les studios de la MGM au tournage de Frontière Chinoise, le dernier film de John Ford, ou croiser King Vidor.
Avec son départ outre-Atlantique, la seconde période de Verneuil s’achève. Au cours de son périple américain, il va acquérir une notion assez précise du type de cinéma qu’il veut désormais faire.
ACTE III
Verneuil signe avec Carlo Ponti (le producteur notamment des films d’Antonioni, de Dr. Jivago ou du Mépris de Godard) puis avec Jacques Bar, et la MGM lui confie les rennes de deux films.
D’abord, La Vingt-cinquième heure avec Anthony Quinn, une adaptation assez réussie du livre de Gheorgiu, qui relate les tragiques pérégrinations de ce paysan roumain pendant et après la deuxième guerre mondiale. Puis La Bataille de San Sebastian, un Western mexicain avec Charles Bronson et Anthony Quinn, où ce dernier est un faux prêtre mais un vrai héros qui va sauver un village des indiens et des pillards.
Après cette expérience américaine, en 1969, Verneuil retrouve la France. Il est désormais qualifié de « plus américain des réalisateurs français ». A partir de cette période, ses films ont changé. Il tourne Le Clan des Siciliens. La réalisation impeccable, la musique (brillante) de Morricone, les images de Henri Decaë, et Gabin, Delon, Ventura, de même qu’une fameuse scène truffée d’effets spéciaux dans laquelle un jumbo jet se pose sur une autoroute en construction : tous les ingrédients sont réunis pour un succès public.
Grâce à la complicité de Vittorio Malanese (Jean Gabin), le jeune Roger Sartet (Alain Delon) s’évade des mains de la justice. Vittorio propose à Roger de monter un coup éblouissant. L’idée est de détourner l’avion transportant des bijoux et de le faire atterrir sur une autoroute en construction. Roger organise les préparatifs, mais il s’éprend de Jeanne (Irina Demick), la propre belle-fille de Vittorio.
Rediffusé de nombreuses fois à la télévision, avec trois grosses têtes d’affiche, le film a gardé aujourd’hui son aspect spectaculaire, même s’il est avant tout taillé sur mesure pour ses acteurs.
Verneuil réalisera par la suite une série d’œuvres interprétées par Belmondo. Ainsi, pendant quelques années, il réalisera des films « à la Lautner » en dirigeant Belmondo dans des histoires survitaminées (« Bébel », son personnage récurrent des années 70, mi-flic mi-voyou au cœur tendre mais aux poings durs).
Le Casse (1971),
Peur sur la Ville (1974)
puis Les Morfalous(1984)
Ce seront des gros succès du box office. Les cascades époustouflantes de Belmondo , les sujets très populaires (vol de bijoux, serial killer, braquage de banque…) et le grand savoir-faire de Verneuil expliquent ces réussites commerciales. Néanmoins, il n’y a plus dans ses films la sensibilité de naguère, et la profondeur des personnages s’est volatilisée au profit de l’action. Et ainsi, tout ce qu’il y a à retenir de cette somme toute médiocre période à la gloire de Belmondo, ce sont les coups de feu, les bagarres, et les crissements de pneus.
Le Corps de mon ennemi (1976) est une exception à la règle. Verneuil tente de se focaliser sur l’ambiance plutôt que sur l’action. Il construit un récit par flashes-back.
François Leclerc (Belmondo) vient de purger une longue peine de prison pour un double homicide qu’il n’a pas commis. A sa sortie, il se rend sur les lieux du meurtre. Il veut retrouver les vrais coupables et les punir. une chasse en règle contre l’endogamie et les faux semblants d’une bourgeoisie dévoyée.
Verneuil filme beaucoup moins désormais, avec des budgets importants, mais ses films n’ont plus qu’une qualité technique, à la manière des films d’action d’Hollywood.
Verneuil avait réuni Yul Brynner, Henry Fonda et Dirk Bogarde — trois stars vieillissantes — dans un thriller d’espionnage, Le Serpent, d’après Pierre Nord, en 1974. Le genre thriller politique plaît à Verneuil, puisqu’il écrit et réalise deux films par la suite.
Ainsi, il s’essaie en 1979 à un plus qu’ honnête thriller politique avec Yves Montand, I…comme Icare, qui met en scène l’assassinat d’un président dans un pays imaginaire.
Le président Jary est abattu par un tireur isolé. L’assassin présumé est retrouvé mort. Le procureur Volney (Yves Montand) et ses hommes mènent l’enquête. Le doute naît dans l’esprit de Volney quand il découvre trop d’invraisemblances. Le tireur ne peut pas avoir abattu le président. A noter également que Verneuil, fasciné par l’expérience sur l’obéissance menée par Stanley Milgram en 1963 à l’université de Yale, en introduit des éléments dans son film pour expliquer le conditionnement de fanatiques poussés à l’assassinat par une organisation. L’expérience est saisissante d’ingénierie et source de nombreuses explications sur la servitude volontaire qui asservit si souvent nos tendres moutons .
A noter quelques éléments similaires entre les dialogues de JFK d’Oliver Stone et ceux de Verneuil, à l’image de ces deux extraits : « Deux tireurs, c’est déjà une organisation. » (Yves Montand) et « And if there was a second rifleman, then by definition, there had to be a conspiracy » (Kevin Costner).
Mille Milliards de Dollars (1981), qui marque la seule collaboration Dewaere / Verneuil, est un thriller bien écrit et rythmé, interprété avec brio.
Paul Kerjean (Patrick Dewaere), journaliste dans un grand quotidien, reçoit un coup de téléphone anonyme. On lui annonce qu’un homme politique, Benoît-Lambert, aurait touché des pots-de-vin pour céder une entreprise d’électronique à une grosse société internationale.
Paul mène son enquête, qui le mène dans le milieu des multinationales. Les trente premières multinationales, découvre-t-il alors, pèsent mille milliards de dollars, l’équivalent du PIB d’un grand pays. Peu de temps après, Benoît-Lambert est retrouvé mort, suicidé, dans sa voiture. Mais était-ce vraiment un suicide ? L’histoire est habile, un peu binaire sans doute, et les rebondissements sont suffisamment nombreux pour susciter l’intérêt jusqu’au bout.
A partir des Morfalous, Verneuil ne reprendra la caméra que pour filmer son autobiographie, en deux parties Mayrig (1991) et 588 rue Paradis (1992), avec Claudia Cardinale, Richard Berry et Omar Sharif.
Hélas, deux films ratés, à cause d’effets trop appuyés. D’autant plus dommage que le livre Mayrig était écrit avec beaucoup de sensibilité et de talent. Verneuil y revient sur l’histoire de son arrivée en France dans le Marseille des années 20, sur ses difficultés d’intégration, sur l’amour de ses parents, sur ses études… Mayrig aura été un best-seller et fut traduit dans de nombreuses langues.
Depuis Mayrig et 588 rue Paradis, Verneuil n’avait pas renoncé au cinéma, puisqu’il parlait de temps à autre d’un projet de thriller.
Ainsi, la troisième période plus décevante de Verneuil ne doit pas faire oublier qu’il savait pourtant fait preuve d’une grande aptitude à peindre les anti-héros, à travers quelques-uns de ses plus meilleurs films.
Mais sa longue collaboration avec Audiard, dont les dialogues sophistiqués sont à l’encontre de ceux, épurés et improvisés, de la Nouvelle Vague, le dessert vis-à-vis des critiques dès les années 60, qui ne lorgnent désormais plus que vers Godard et Truffaut. Pour Verneuil, il s’agit d’un « putsch ». Ces putschistes n’auront de cesse de catégoriser Verneuil avec mépris dans les faiseurs de films du dimanche soir.
On peut néanmoins s’amuser à trouver des points communs entre le cinéma de Verneuil et celui de la Nouvelle Vague. L’utilisation fréquente des extérieurs au lieu des studios ou la peinture occasionnelle d’anti-héros symbolisés par le Belmondo d’A bout de souffle en sont des éléments incontestables.

Que l’on ne s’y trompe pas, nous ne prétendons pas rapprocher Verneuil de Resnais ou Rohmer. Mais à l’inverse, ignorer son talent de conteur serait une grave erreur. Peut-être est-il arrivé à une mauvaise époque. Son amour pour le cinéma américain hollywoodien et le cinéma « populaire », son intransigeance envers un certain cinéma d’auteur intellectuel et affecté le rangeraient aujourd’hui auprès de Besson, Kassovitz ou Gans. Si l’on veut bien chercher ses films plus méconnus, plutôt que de juger Verneuil à sa « troisième période » certes plus notoire, on comprendra aisément qu’il était plus que ce que certains journalistes ont péremptoirement écrit sur lui.
Mais les films de Verneuil ont vieilli. Le rythme du montage a accéléré, notamment sous l’influence du clip, et les acteurs, de gros bonnets du cinéma français, appartiennent maintenant au passé. Et si la photo est presque toujours extrêmement soignée (grâce aux talentueux Louis Page et Henri Decaë notamment), les décors, les costumes appartiennent manifestement au passé.
Chez Verneuil, en outre, les histoires sont incontestablement dominées par des hommes. Les femmes en sont étrangement absentes. A de rares exceptions près (comme dans Maxime ou dans Les Amants du Tage), elles ne tiennent que des rôles secondaires et caricaturaux. Machiste dans sa première période (c’est souvent le propre des Gabin et des Audiard), le cinéma de Verneuil se remplit de testostérone dès la fin des années 60 avec des héros supermusclés comme « Bébel ».
On regrettera sans doute que le Verneuil de Le Casse ou Les Morfalous ait pris le pas sur le Verneuil de Des Gens Sans Importance ou Week-end à Zuydcoote. Dans ces films de première période, il faisait montre de sa profondeur évidemment humaniste, moins spectaculaire mais plus profondément marquante que les films d’action qu’il a réalisés. Dommage qu’il ait cru devoir suivre un certain cinéma américain.
Il a mis dans les dernières années de sa vie ses origines au profit de la cause arménienne ; le film Mayrig aura vraisemblablement contribué à faire parler du génocide arménien et à obtenir sa reconnaissance par le Parlement français.
Il avait été admis depuis peu à l’Académie des Beaux-Arts, pour laquelle il avait composé un discours inaugurateur qui rendait hommage à ses films favoris. Il y citait de nombreux cinéastes, dont Besson, signe de son amour pour un cinéma commercial, proche du public. Le cinéma français l’a finalement gratifié d’un césar d’honneur en 1996, qu’il avait accepté avec beaucoup de plaisir. Deux récompenses, sans doute pour lui davantage deux reconnaissances, qui l’auront réconcilié avec un pays où il s’est souvent senti étranger.

Ainsi, Henri Verneuil, grand professionnel du cinéma qui adorait conter et raconter, n’est plus ; il a marqué à sa manière d’une empreinte tenace le cinéma français des années 50, 60 et 70, et a su presque à chaque coup obtenir l’adhésion du public. Aujourd’hui encore, à la télévision, nombre de ses films représentent des valeurs sûres, et rediffusion après rediffusion, on pourra constater sa contribution au patrimoine du cinéma populaire français.
http://www.ina.fr/video/CPD07008351
DECLARATIONS D’HENRI VERNEUIL
« Le cinéma est né dans les kermesses, a vécu dans les faubourgs, et s’est épanoui sans l’aide des gens cultivés. »
« Il se produit un phénomène très étrange dans notre pays. Prenons un film français et son équivalent américain inspirés par les mêmes sources. Le film américain provoquera un concert admiratif de louanges et le français se fera descendre. Simplement parce que chez nous sévit le manuel du parfait intellectuel, le bréviaire auquel on doit sans cesse faire référence si l’on veut briller. »
« Si je n’ai rien à raconter, je me tais. »
« Je dois mes débuts dans le long-métrage à Fernandel. »
Gabin-Delon par Henri Verneuil
« D’un côté, un pachyderme. Lent. Lourd. Les yeux enfoncés sous des paupières ridées et, dans l’attitude, la force tranquille que confère le poids. Celui du corps. De l’âge. De l’expérience. Quarante ans de carrière. Quelque soixante-dix films : Gabin. De l’autre, un félin. Un jeune fauve, toutes griffes rentrées, pas un rugissement mais des dents longues et, dans le regard bleu acier, la détermination de ceux qui seront un jour au sommet : Delon. » (Télé 7 Jours 6 juillet 1981)
Jean-Paul Belmondo par Henri Verneuil
« Mon regret, c’est de ne pas voir dirigé John Wayne, Clark Gable ou Spencer Tracy, mais j’ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Belmondo, qui, à lui seul, les résume tous. Ce qu’on admet chez Gary Cooper, on ne le reconnaît pas chez Jean-Paul Belmondo. Quand il descend le long d’un filin suspendu à un hélicoptère, il peut jouer Néron lorsqu’il arrive en bas. »
Ennio Morricone par Henri Verneuil
« Souvent on me demande comment j’ai pu travailler aussi longtemps avec un même compositeur sans avoir avec une seule langue en commun. La réponse est simple : Ennio est moi oeuvrons pour le cinéma, forme d’expression dont le langage est universel. Nous nous sommes aussi toujours compris à travers un charabia d’une grande efficacité. A d’autres reprises, je saisisssais parfaitement sa démarche – ou lui la mienne – en un mot, qu’il soit français, italien ou anglais. Sur ce plan, aucune ambiguïté : Ennio et moi sommes e la même nationalité par le coeur. »

DECLARATIONS SUR HENRI VERNEUIL
Anthony Quinn
« Henri a le même sens du grand spectacle que les américains. C’est rare chez les réalisateurs européens. »
Jean-Paul Belmondo
« L’avantage avec Henri, c’est que quand je fais une cascade, je suis sûr qu’elle va être très bien filmée, que les gens vont la voir et que les gens verront que c’est l’acteur qui fait cette cascade. C’est déjà un atout énorme. »
Patrick Dewaere
« Henri sait exactement ce qu’il veut. »
« Quand Henri Verneuil vous propose de faire un film avec lui, on refuse pas, parce que Henri Verneuil c’est Henri Verneuil. C’est énorme dans le cinéma français et y a pas de raison que ça continue pas. »